Par Louise P., L3 cinéma
La reprise est “la condition pour que puisse émerger des formes radicalement neuves.” Rodolphe Olcèse, Le surgissement des archives.
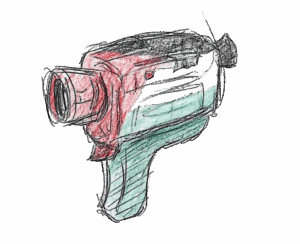
Avant de commencer !
Nouvelle année universitaire, nouvelle rubrique de cinéma. Alors que Ciné’Mood penchait vers le côté esthétique d’un film dans le but de toucher un large public, Photogramme se place dans une analyse plus universitaire. Articles plus longs, plus techniques, dans le but de décortiquer des films moins accessibles, sans nécessairement de trame narrative, allant de l’expérimental jusqu’au documentaire. Certains textes ou livres sur le cinéma pourront également trouver leur place dans cette rubrique.
Interlude
Plan d’ensemble
Images floues, ralenties, encore et encore, les mêmes. Les figures humaines du premier plan disparaissent, effacées, et ne laissent qu’une ville fantôme en ruines. Progressivement, les véritables habitants du lieu désert sortent des décombres : silhouettes floues, presque immobiles, nous fixant, effrayées par l’arme filmique qui les vise, recommençant les mêmes gestes, le même trajet, les mêmes pas, encore et encore. Seule rescapée : la mer, imbattable, se tenant farouchement face aux ruines d’une vie détruite.
S’imposent à nous des extraits, très courts, rapides, faisant l’effet d’un coup de feu visuel. Un homme s’amuse à battre un mannequin de tissu. Suite à cela sont montrés un grand hôtel de luxe, des voitures longeant la côte, dans un décor paradisiaque. Il n’y a plus de flou, l’image semble ne pas le supporter, elle est à l’envers (ce point sera expliqué plus en détail par la suite). Une femme se trouve dans un appartement abandonné. Elle monte des escaliers, que le sens de l’image fait aller vers le bas. À nouveau, nous retournons sur ces figures fantomatiques, qui, progressivement, comme une quête, reprennent leur identité, leur visage, s’éloignant avec peine du flou de l’histoire, loin du rôle de figurant oubliable et sans importance. Rendus immortels par ces zooms, ces inserts, ces ralentis et ces répétitions, elles retrouvent leur place dans leur ville : Jaffa, et dans l’histoire israélo-palestinienne, comme un peuple qui résiste, à l’image de la mer :
“You cannot beat the sea” (“Tu ne peux pas vaincre la mer”) me répondit Kamal Aljafari

Décomposition
La quasi-totalité des images du film Recollection proviennent de fictions israéliennes ou américaines, tournées à Jaffa, car “Tel-Aviv est une ville trop récente pour ne pas paraître comme un décor de studio à l’écran”(1). La date de ces archives varie, mais toutes ont été tournées en 16mm, et proviennent de la collection personnelle du réalisateur. La caméra ayant tourné ces images est israelo-américaine, expliquant le regard effrayé des silhouettes fixant la camérarme. “Camérarme”, parce que la colonisation est culturelle, et que le cinéma est une arme de persuasion massive. S’approprier une terre en effaçant ses habitants, quoi de plus symbolique ! La colonisation possède ses propres patterns (“motifs”), elle envahit, prend possession des lieux, tout comme le cinéma : filmer pour posséder le clone cinématographique des choses :
“eaten by the camera” (“mangé par la caméra”)
Le film de Kamal Aljafari est rythmé lui aussi par des patterns, affichant le caractère cyclique de l’histoire, et d’une histoire : celle de la colonisation israélienne en Palestine. Ici la comparaison avec le film No Other Land (2024) de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham et Rachel Szor est pertinente sur la question du cycle des destructions : un bâtiment par semaine, encore et encore. Ce type de violence est notamment psychologique. La répétition de la destruction ne s’arrête jamais, et ne vise qu’une maison à la fois, comme un massacre lent, une torture, goutte à goutte, rendant tout répit impossible, et permettant un espoir pourtant vain.

Souvenez-vous maintenant de l’image inversée. Ce fut ma première question au réalisateur. Cette scène provient d’un film racontant l’histoire d’une femme aveugle qui retrouve la vue, mais ne reconnait l’endroit que par le toucher. Face à une ville dépossédée de son existence matérielle par un cinéma colonial, il faut s’enfoncer dans le plan, pour le toucher, presque à la façon de la caméra analytique qu’utilisent Angela Ricchi Lucci et Yervant Gianikian dans leurs films de remontages d’archives(2). Il faut plonger dans l’image coloniale pour redonner une matérialité à la ville par les autres sens que la vue, pervertie par la camérarme, d’où l’importance de la simulation du toucher, ainsi que l’ouïe. Ce rapprochement entre sujet filmé et support filmique, physique, fait également écho à leur travaux(3). Ici, l’inversion de cet extrait provient d’un problème technique lors du visionnage de la pellicule, que Kamal Aljafari trouva fort pertinent :
“Jaffa is also upside down.” (“Jaffa est également sans dessus dessous.”)
Pour retrouver cette ville, qui a perdu son visage à l’écran, il faut donc la toucher, la sentir. S’expliquent alors les nombreux inserts sur les murs et les pavés, qui, selon le cinéaste, permettent, non seulement de façonner la “structure du film”, comme s’il reconstruisait brique par brique sa ville natale, mais également de dépasser le contexte, et d’atteindre une histoire universelle de la colonisation :
“abstraction leeds to universality” (“l’abstraction mène à l’universalité”)
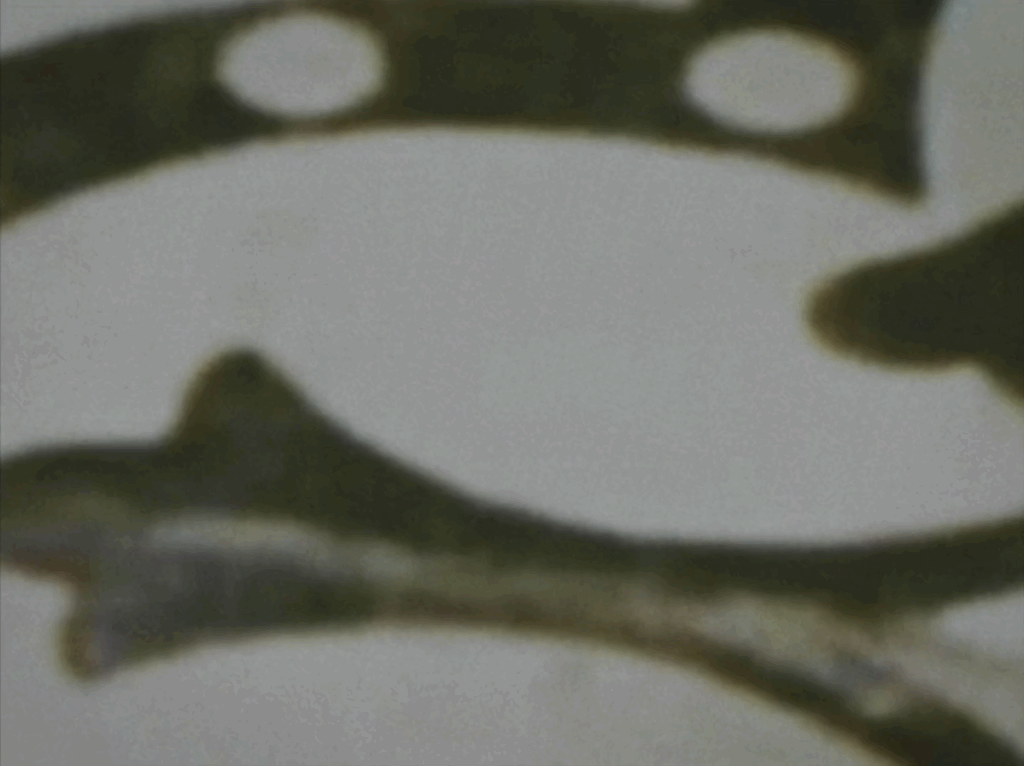
Le son utilisé met également en évidence cette idée d’universalité, selon les propres dires du réalisateur. Ce son urbain, un peu étrange, lointain, est un enregistrement de la ville de Berlin à la nuit tombée, fait par ce dernier. Quelques bruits, beaucoup de silences, mais jamais complets, le son de la nuit nous est tous familier, et semble procurer une sensation de déjà-vu pouvant s’inscrire dans une forme de sentiment nostalgique. Cette bande son participe alors à la création du fantôme de Jaffa. Il ne reste d’elle qu’un clone cinématographique étranger.
Puisque la réalité a été éradiquée, puisqu’il ne reste rien, puisque tout est détruit, Kamal Aljafari cherche à la ciné-loupe dans les décombres d’une fiction coloniale les restes de silhouettes inconnues pour nous, familières pour lui, récit universel pour nous, portrait intime pour lui. Et les témoignages personnels deviennent alors objets de lutte…
Le réalisateur a en effet raconté comment il avait récupéré de nombreux témoignages en imprimant et montrant aux habitants de Jaffa les recadrages des figurants, dans le but de mettre des noms sur ces visages flous. A la fin du film, une longue liste les nomme tous, et leur redonne alors une identité. Mais un nom inconnu n’humanise pas autant qu’un lien : “la soeur de”, “le fils de”, “la mère de”. Rien n’est plus universel que les relations entre les gens. Quiconque, même à l’autre bout du monde, peut alors s’y reconnaître. La beauté de ce film se trouve dans sa position en contrepoint avec une prise de recul. Nous plongeons dans la mer de la mémoire, de chaque mémoire, pour y saisir chaque brique, chaque silhouette, comme des collectionneur.euses effrayé.es d’une amnésie préméditée par une fiction coloniale devenue cheval de Troie : Recollection.
Et la camérarme coloniale est détournée, réappropriée, comme l’est le clone cinématographique de Jaffa à travers ce film.
Pour aller plus loin ?
A Fidai Film de Kamal Aljafari parle plus spécifiquement de l’éradication des archives palestiniennes par les israéliens, film qui ferait peut-être l’objet d’un prochain Photogramme.
